Michel ROGALSKI
Titres des médias, émissions de télévisions ou de radios, réseaux sociaux, la collapsologie est partout. La pandémie virale en cours dope son discours et ajoute à l’ambiance catastrophiste. Bref, le contexte est porteur et alimente peurs et inquiétudes. Des solutions sont proposées dont les racines puisent dans de lointaines sources qui s’abreuvent à différents registres : littérature de science-fiction, cinémas, groupes écologiques, instituts mondiaux de recherche. Derrière ce foisonnement, parfois confus, on retrouve un affrontement d’idéologies qui émargent à différents champs disciplinaires et questionnent des notions aussi vastes que l’optimum de la population mondiale, la crainte de l’épuisement des ressources, le rôle de la technologie et de la science, le sens du progrès, la fragilité des sociétés, la résilience des écosystèmes, la nécessité ou la nature de la croissance dans un monde qui serait fini, etc. En réalité, des préoccupations pas vraiment nouvelles, mais qui combinées présentent un tableau effrayant et cristallisent des interrogations anciennes.
Le Rapport Meadows (du nom de son principal rédacteur) connut un impact intellectuel et politique retentissant et alimenta de nombreuses polémiques. Il a puissamment contribué à favoriser l’émergence d’un doute quant à la possibilité de la poursuite ininterrompue d’une croissance toujours accélérée. Il a accompagné – notamment en France – des réinvestissements militants en faveur de l’écologie et a dopé la première candidature présidentielle en la personne de René Dumont. Deux propositions clés se dégageront : stabiliser la population mondiale et limiter la production – en réalité ni l’arrêter, ni la rendre négative, mais la ralentir – afin de freiner la pollution et la consommation de ressources naturelles. Le Rapport délivre l’idée que nous serions à la croisée des chemins – image depuis lors rebattue – et que faute de savoir choisir et décider, le pire ne peut qu’advenir rapidement. Ainsi « décider de ne rien faire, c’est décider d’accroître le risque d’effondrement ».
Les critiques furent nombreuses. Elles discutèrent les hypothèses et pointèrent les oublis manifestes.
Il fut reproché au modèle de ne pas prendre en compte la diversité du monde et les inégalités sociales. Alors qu’à cette époque, même la Banque mondiale raisonnait sur l’existence d’un Nord et d’un Sud et sur l’inégale distribution sur la planète de diverses ressources. Il lui fut également reproché d’écarter l’influence du facteur humain dans sa capacité à modifier ses styles de vie ou ses modes d’organisation dans la trajectoire déroulée. En effet, isoler les êtres humains de leur façon de vivre est un exercice vain. Les crises financières, les guerres ou les épidémies étaient également absentes du modèle.
Mais l’hypothèse la plus controversée porta sur le concept de ressource. Le fil qui parcourt l’ouvrage laisse entendre qu’il s’agirait d’un stock de différents gisements dont l’évaluation serait faite une fois pour toute et qui ne pourrait aller qu’en s’épuisant au fur à mesure du développement de l’activité économique. Or toute l’histoire montre le contraire à savoir que l’activité humaine est aussi créatrice de ressources dont l’évaluation ne peut être figée parce que dépendante du progrès technique, des avancées scientifiques et des prix relatifs. Nous n’avons connaissance ni de toutes les ressources qui sont disponibles, ni de la façon de les utiliser. Les limites de l’étendue de la connaissance constituent le principal facteur de la « limite des ressources ». Or la science crée des ressources jusqu’alors insoupçonnées. Le charbon a vu son usage dopé par l’invention de la machine à vapeur, le pétrole par celui du moteur à explosion et de la chimie, l’uranium par la percée des mystères de l’atome, les terres rares par le développement des procédés de communications modernes, l’espace par l’invention des satellites et la capacité à les lancer, etc. On l’aura compris, le véritable problème auquel l’humanité est confrontée n’est pas celui de l’épuisement des ressources mais celui de leur utilisation à l’origine de pollutions transformant la planète en immense poubelle. Dans de tels écosystèmes dégradés, l’homme ne peut plus survivre. La menace de réchauffement climatique ne s’est jamais expliquée par la raréfaction de ressources mais au contraire par une utilisation démesurée de celles-ci, en particulier de celles d’origine fossile et susceptible d’émettre des gaz à effet de serre. Bref, c’est l’excès de ressources et de leur exploitation qui crée le principal problème et non leurs limites. Les « découvertes » de nouvelles ressources constituent le phénomène majeur de notre époque.
Le Rapport Meadows n’envisage d’aucune façon la fragilité des systèmes industriels et des grands réseaux qui maillent la planète et sont devenus indispensables à l’activité humaine. Au-delà du risque industriel classique, à effets limités, ces réseaux par leur interconnexion présentent des risques systémiques qui mettent la planète sous la menace d’une panne ou d’un accident. La contagion serait immédiate et affecterait toute activité sous différents aspects. Les conséquences d’une perturbation durable dans l’espace satellitaire, les câbles sous-marins, les réseaux électriques, la toile internet, les réseaux d’eau, de transports ou de flux de données, etc. seraient incalculables et paralyseraient des pans entiers de l’activité humaine.
Évidemment de la décroissance à l’effondrement il n’y a qu’un pas, allègrement franchi par les tenants de ces théories. Avec une différence qui doit être notée par son importance. Les « décroissants » formulent des propositions pour réorienter l’activité économique et les styles de vie de la société. Ils s’inscrivent dans une démarche collective, même s’ils ne semblent pas s’être rendus compte que dans les pays industrialisés la croissance n’est plus au rendez-vous déjà depuis plusieurs décennies. Alors que les prophètes de l’effondrement sont déjà gagnés par le sentiment de la résignation et n’envisagent plus que des solutions individuelles ou adaptées pour de petites communautés traditionnelles présentées comme résilientes. La situation est à leurs yeux tellement dégradée qu’il n’existe plus aucun espoir collectif de portée réaliste pour la redresser. L’alternative est dans le « pas-de-côté » ou le débranchement pour assurer la survie. Ces conceptions laissent peu de place ou une indifférence au combat social et à ses acquis ou à la nature capitaliste du système économique qui mène à la catastrophe, ou à la dénonciation des mécanismes de l’exploitation. Les préoccupations du plein-emploi sont absentes et inutiles puisque la perspective de l’effondrement est certaine et qu’en plus les auteurs sont pour beaucoup adeptes des théories de la « fin du travail ». Ces travaux traduisent en dernier ressort une impasse sur la capacité d’agir et la possibilité d’en imaginer la moindre esquisse. Ils trahissent de surcroît deux obsessions majeures. L’une, considérant, dans une vision malthusienne, que la surpopulation serait la principale source des problèmes de la planète, alors même que tous les spécialistes s’accordent sur une stabilisation mondiale autour de neuf milliards de personnes vers 2050. L’autre, dans un rejet de la modernité et du progrès au sens des Lumières, fondant une société émancipée des appartenances traditionnelles, des déterminations métaphysiques ou des croyances irrationnelles. Évidemment, ce courant de pensée ne peut se prévaloir du statut de « nouvelle science » dont il cherche indûment à se réclamer. Il s’agit plutôt d’un inventaire hétéroclite emprunté à diverses disciplines en sélectionnant ici et là arguments et faits susceptibles d’illustrer leurs propos dans le but de naturaliser les phénomènes sociaux. Cette pensée représente une impasse réactionnaire.
Michel Rogalski, « De la décroissance à l'effondrement »
(Présentation)
***
On sait combien le siècle dernier fut lourd d’affrontements, de guerres, de crises et de bouleversements mondiaux et comment il nourrit, en finissant, l’espoir que le prochain serait meilleur.
Déjà bien entamé, l’actuel accumule rapidement tous les ingrédients de menaces et de périls dont l’identification se précise sans que les problèmes du siècle dernier aient pour autant disparus. On retiendra pour mémoire, au risque d’être incomplet, la misère et les inégalités grandissantes, la puissance des multinationales et de la finance mondialisée, le pouvoir incontrôlable des Gafas et le poids opaque des réseaux asociaux qu’ils stimulent, la montée des flux migratoires à la fois inévitable et impossible, la prolifération des réseaux maffieux notamment articulés à ceux de la drogue et bien sûr la quête d’hégémonie mondiale par certains pays qui la pensent naturelle et la mettent au coeur de leur stratégie avec tous les moyens de leur puissance et n’hésitent pas à brandir le moyen de l’arme nucléaire. À ces périls, trame de fond à laquelle on pourrait s’accoutumer, s’ajoutent aujourd’hui des menaces qui se laissent entrevoir et qui accompagneront le XXIe siècle.
Le retour des extrémismes religieux
André Malraux nous avait mis en garde sur le retour du religieux. Sans être entendu, tellement nous étions persuadés que l’entrée dans l’ère des Lumières, de la raison, de la science et du progrès ne pouvait conduire qu’à un monde débarrassé de ces croyances. Tous s’accordaient sur la disparition de la présence divine dans la gestion des affaires du monde. On croyait acquis de façon définitive que les lois divines n’auraient plus cours sur terre dès lors que les hommes avaient pris leur destin en main et pensaient pouvoir décider eux-mêmes des lois qui régiraient leurs relations. On a cru à une grande bifurcation de l’humanité. Le monde qui se dessine semble en être très différent. De partout, des signes montent qui attestent non seulement du retour du religieux, mais de ce qu’il peut véhiculer de pire. C’est sous la forme d’idéologie théologico-politique, moyenâgeuse, rétrograde et parfois barbare que la renaissance conquérante s’opère.
L’ensemble du continent américain est sous l’influence montante des sectes évangéliques et de toutes les formes de crédulités sectaires. Ces forces jouent déjà des rôles majeurs dans maints pays d’Amérique latine et ont contribué aux virages politiques des dernières années. Elles s’inscrivent toutes dans la mouvance des droites extrêmes et disposent d’importants moyens financiers. Aux États-Unis, ces Églises comptent plus de 90 millions d’adeptes et prennent appui sur près de 200 élus au Congrès. Mais aujourd’hui la religion la plus « opiacée » est la religion musulmane dont la fraction sunnite se déchire autour de l’interprétation des textes sacrés et a donné naissance à des courants se réclamant du salafisme ou des Frères musulmans. Certains se sont lancés dans le djihadisme avec succès puisqu’ils ont défait une première fois les Soviétiques en Afghanistan, puis une seconde fois une coalition occidentale emmenée par l’Otan. Aujourd’hui les talibans y sont ainsi aux portes du pouvoir. Battus – mais à quel prix – en Algérie et en Syrie, ils se répandent en Afrique, du Maghreb au Mozambique, et ambitionnent d’étendre leur influence en s’appuyant sur de fortes diasporas installées dans le monde occidental. Là, ils travaillent les communautés musulmanes en essayant de leur faire croire qu’elles ne pourraient pas y pratiquer pleinement leur culte et les invitent à défier les principes de la République contraires aux lois divines. Les puissances publiques sont tétanisées, ne sachant comment agir. Elles internationaux. Chacune de ces poupées relève d’une approche différenciée. La troisième relève d’une neutralisation et concerne des services spécialisés dans la guerre de l’ombre. La deuxième relève d’un conflit interne à la religion musulmane qui rend toute tentative d’ingérence en situation d’extériorité contre‑productive car elle n’aurait d’autre effet que de désigner les « bons » croyants suspects de pactiser avec les mécréants. Avec la première, la communauté musulmane, tout doit être mis en œuvre pour que cessent les politiques discriminatoires qui n’ont d’autre effet que de nourrir des aspirations sécessionnistes alimentées par le sentiment d’appartenance à une oumma mondialisée dont les règles s’imposeraient à toutes lois nationales. Cette « double allégeance » ne peut être contrariée que par une meilleure intégration. En faire l’impasse, comme multiplier les interventions armées en terre musulmane, ne peut que conduire à l’échec. Car l’enjeu c’est la première poupée russe qu’il convient de ne pas égratigner en réduisant les deux autres.
Climat : la lettre qui change tout !
La seconde grande menace qui accompagnera tout le siècle à venir concerne la perspective du changement climatique. Depuis le sommet de Rio en 1992, la question figure dans les priorités de l’agenda international. Elle remet en cause des intérêts essentiels de la vie économique. Tout est à revoir. La façon de produire, de consommer, de se loger, de se transporter, de s’alimenter, etc. Bref, il s’agit d’inventer une société décarbonée et promouvoir des modes de production et des styles de vie plus respectueux de l’environnement. On comprend l’ampleur des réticences et les efforts consacrés par certains à mettre des freins à toute évolution dans cette direction. Ceux qui s’estiment lésés par de tels changements ne restent pas inactifs. Ils sont nombreux et occupent des places de pouvoir. Ils n’ont pas hésité à rallier à eux quelques quarterons de scientifiques et de lobbies qui ont contribué à diffuser un climato-scepticisme. Mais depuis une quarantaine d’années le débat d’idées les a fait peu à peu reculer, les obligeant tout d’abord à sortir du déni sur la réalité du réchauffement, puis à admettre le caractère indiscutable du rôle du facteur humain, même si quelques discussions peuvent encore porter sur la part de la contribution anthropique ou des cause naturelles. La communauté internationale, dans la foulée du Protocole de Kyoto signé en 1997, mais seulement ratifié en 2003, s’est engagée dans de vaste sommets étatiques mondiaux annuels dont les plus marquants furent ceux de Copenhague (2009) et de Paris (2015), généralement envahis par les associations environnementales. L’objectif étant de définir l’ampleur des efforts à consentir et surtout leur rythme. Un consensus est ainsi apparu autour de l’idée qu’il s’agissait d’une menace globale pour la poursuite de l’activité humaine sur la planète et donc sur l’urgence d’agir. À plusieurs reprises, des préconisations ont été formulées pour insister sur l’urgence des actions nécessaires et sur le coût potentiel engendré par tout retard à leur mise en œuvre. Le débat porte également sur les formes de régime de coordination internationale efficace, les critères et les instruments d’analyse économique utilisables pour permettre l’implication équitable des différents états et l’acceptation par les opinions publiques des coûts associés aux mesures nécessaires.
À l’approche des grands sommets qui ponctuent ces luttes, les milieux associatifs et les partis politiques s’emploient à accompagner l’événement à coups de déclarations et prises de positions reflétant un arc-en-ciel de postures. Dans la société civile, un mot d’ordre semble s’être imposé, fier de sa radicalité : « Changeons le système, pas le climat ».
Que beaucoup pensent qu’il est nécessaire de pointer les responsabilités et notamment les logiques d’un système économique qu’il convient de renverser relève du bon sens. À condition de garder en tête la spécificité du climat en tant que bien commun ayant vocation à concerner toute la population. Sans prendre le risque donc d’écarter inutilement des combats nécessaires tous ceux qui ne brandiraient pas un passeport antisystème. À condition également de ne pas oublier que la problématique climat est marquée par son caractère d’urgence qui impose un agenda beaucoup plus immédiat que celui du changement de système. Confondre les temporalités considérer comme négligeable dans les actions à entreprendre.
Lorsqu’il s’agissait de défendre la paix – autre bien commun –, il n’était pas demandé aux foules qui descendaient dans la rue de s’approprier une analyse des complexes militaro-industriels et de leurs relations avec le système économique. Chacun venait sur la base de ses motivations : éthique pour le monde religieux, sociale pour les syndicats, etc.
Le mot d’ordre : « Changeons le système par le climat » constitue une invite plus ouverte et plus responsable. Comme quoi, une simple lettre peut tout changer. Cela mérite un débat sur la façon d’approcher les luttes sur les biens communs.
L’ampleur des efforts à faire pour changer de trajectoire est immense. Des moyens considérables devront être mobilisés. Comment imaginer que tous ceux qui sont victimes, ici et maintenant, des pires maux qui frappent la planète accepteront facilement que soient « détournés » ces moyens au bénéfice de générations futures, alors que la question qu’ils affrontent est celle de leur survie au quotidien. Vouloir les associer au sauvetage du climat sans satisfaire dès à présent leurs besoins pressants les plus essentiels ne saurait conduire qu’à l’impasse. Et le mouvement des « Gilets jaunes » nous a signifié que la conflictualité entre la fin du mois et la fin du monde n’était pas que l’apanage du tiers-monde.
Michel Rogalsky, « Notre siècle et ses périls »
(Éditorial)
Michel Rogalski, Notre siècle et ses périls [Éditorial]DOSSIER
Xavier Dupret, Chine versus États-Unis. Analyse d’une réalité
Rémy Herrera, Zhiming Long,
Zhixuan, Bangxi Li, Guerre commerciale sino-étatsunienne : le vrai « voleur » enfin démasqué !
Patrice Bouveret, Sous le sable, la radioactivité ! Contentieux nucléaire entre l’Algérie et la France
DE LA DÉCROISSANCE À L’EFFONDREMENT
Michel Rogalski, De la décroissance à l’effondrement [Présentation]CONTROVERSES
Stéphanie Treillet, La collapsologie, une impasse réactionnaire
Michel Rogalski, « Le Rapport au Club de Rome : halte à la croissance ? » : un texte fondateur
Jérôme Leroy, La science fiction nous avait pourtant prévenus !
Pierre Salama, 2020, Covid-19, un tsunami dans les pays avancés
L’ONU TOUJOURS UTILE ?
Célhia de Lavarène, L’ONU est-elle toujours la caisse de résonnance des problèmes du monde ?NOTES DE LECTURE ET FILMS
Chloé Maurel, L’ONU, plus que jamais indispensable dans le monde périlleux des années 2020
Anne-Cécile Robert, L’ONU menacée par les grandes puissances : à quoi joue la diplomatie française ?
Bertrand Badie, Intersocialités – Le monde n’est plus géopolitique [Michel Rogalski]Coordination du dossier : Michel Rogalski
Thomas Guénolé, Le Livre noir de la mondialisation ; 400 millions de morts [Pierre Guerlain]
RBG, documentaire de Julie Cohen et Betsy West ; On the basis of sex (Une femme d’exception) un film de Mimi Leder [Anne-Marie Bidaud]
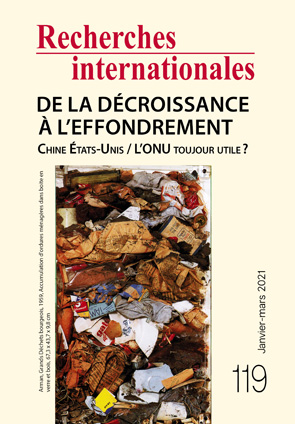
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire