Marion LARCHÉ
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est marquée par un double mouvement, celui de l'intensification du recours aux sources du droit international et celui de leur diversification. L'évolution de l'environnement international dans lequel la Cour exerce son office, la composition de la formation de jugement, la nature des contentieux dont elle est saisie ou encore la teneur de l'argumentation exposée par les parties et les tiers intervenants constituent indéniablement des facteurs d'impulsion d'un tel phénomène. Face à une pratique prétorienne a priori incohérente et résolument casuistique, cette étude entend proposer une systématisation de l'utilisation des sources internationales par le juge.
TABLE DES MATIÈRES
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est marquée par un double mouvement, celui de l'intensification du recours aux sources du droit international et celui de leur diversification. L'évolution de l'environnement international dans lequel la Cour exerce son office, la composition de la formation de jugement, la nature des contentieux dont elle est saisie ou encore la teneur de l'argumentation exposée par les parties et les tiers intervenants constituent indéniablement des facteurs d'impulsion d'un tel phénomène. Face à une pratique prétorienne a priori incohérente et résolument casuistique, cette étude entend proposer une systématisation de l'utilisation des sources internationales par le juge.
L'analyse du corpus jurisprudentiel - qui repose sur une méthode inductive - invite à adopter une approche fonctionnelle. D'une part, les sources internationales disposent d'une fonction interprétative dans la jurisprudence puisqu'elles constituent une ressource pertinente afin de dégager le sens des énoncés conventionnels et d'alimenter la démarche herméneutique du juge. D'autre part, elles sont appelées à remplir une fonction régulatrice en ce qu'elles participent, par la modulation du contrôle des obligations à charge des Etats parties et par la préservation de l'autorité de la Cour, au fonctionnement correct du système et à sa cohérence. Il en ressort que l'utilisation des sources du droit international s'inscrit dans une stratégie jurisprudentielle déterminée, orientée vers le maintien de l'équilibre du système conventionnel qui impose d'allier respect de la souveraineté des Etats parties et protection effective des droits de l'Homme.
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Avant-propos, Sébastien Touzé, Professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation René Cassin - Institut international des droits de l'Homme
Préface, Laurence Burgorgue-Larsen, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sommaire
Liste des sigles et abréviations
Avant-propos, Sébastien Touzé, Professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation René Cassin - Institut international des droits de l'Homme
Préface, Laurence Burgorgue-Larsen, Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sommaire
Liste des sigles et abréviations
INTRODUCTION
I. L’utilisation des sources internationales par le juge : un objet de systématisation
II. Comprendre l’utilisation des sources internationales par le juge : la construction de l’œuvre de systématisation
III. Lever le voile sur l’utilisation des sources internationales par le juge : l’objectif de l’œuvre de systématisation
PREMIÈRE PARTIE
LA FONCTION INTERPRÉTATIVE
LA FONCTION INTERPRÉTATIVE
Titre 1. Les facteurs d’impulsion de la fonction interprétative
Chapitre 1. Une fonction favorisée par l’évolution de l’environnement de la Cour
Section 1. Une fonction favorisée par l’évolution de l’environnement externe
§ 1. Le développement des sources d’inspiration à disposition du juge
A. La multiplication et la diversification des instruments de protection§ 2. L’acclimatation de la Cour à ce nouvel environnement international
B. Un décloisonnement général du processus herméneutique
A. Une évolution du rôle de la Cour propice au réflexe d’extériorisationSection 2. Une fonction favorisée par l’évolution de l’environnement interne
B. Une transformation de la nature des contentieux favorable au réflexe d’extériorisation
§ 1. L’amélioration bénéfique des moyens matériels mis à la disposition de la Cour
A. L’amélioration déterminante de l’accès aux ressources§ 2. La diversification des sources internationales favorisée par la composition de la Cour
B. Le renforcement non négligeable des moyens humains au sein du greffe
A. Le changement de profil des membres de la Cour
B. La révélation des différentes perceptions des membres de la Cour au sein des opinions séparées
Chapitre 2. Une fonction encouragée par l’argumentation des parties et des tiers
Section 1. L’intégration progressive des sources internationales dans l’argumentation des parties et des tiers
§ 1. L’intensification du recours aux sources internationales par les parties
§ 1. Le choix opportun des méthodes d’interprétation et des techniques argumentatives
A. L’invocation fréquente des sources internationales§ 2. Le recours variable aux sources internationales par les tiers
B. La diversification des sources internationales invoquées
A. Le recours mitigé des États aux sources internationalesSection 2. L’utilisation stratégique des sources internationales par les parties et les tiers
B. Le recours limité du Commissaire aux droits de l’Homme aux sources internationales
C. Le recours exponentiel des ONG aux sources internationales
§ 1. Le choix opportun des méthodes d’interprétation et des techniques argumentatives
A. L’articulation judicieuse des sources invoquées avec les méthodes d’interprétation§ 2. L’invocation finaliste des sources internationales
B. Le choix stratégique des techniques argumentatives
A. Les sources privilégiées par les États pour restreindre la compétence de la Cour§ 3. La réception des sources invoquées
B. Les sources internationales mises à profit dans la détermination du contenu des droits conventionnels
A. Une exercice persuasif difficilement mesurable
B. Une influence perceptible
Titre 2. La dimension stratégique de la fonction interprétative
Chapitre 1. La révélation du pouvoir discrétionnaire de la Cour
Section 1. Une pratique jurisprudentielle fluctuante
§ 1. Une ouverture indépendante de l’existence de certains vecteurs de circulation
A. Une pratique indépendante de l’existence de renvois textuels§ 2. Une insaisissable opération de détermination des sources internationales utilisées
B. Une pratique indépendante des sollicitations des parties et des tiers intervenants
A. Le rejet du caractère « pertinent » des sources internationales comme critère méthodologique exclusifSection 2. La versatilité des justifications apportées par la Cour
B. L’absence de véritable critère objectif dans la sélection des sources utilisées
§ 1. Une justification souvent passée sous silence
A. L’absence totale et fréquente de justification§ 2. Une pratique combinée avec une pluralité de méthodes d’interprétation
B. Des tentatives non convaincantes de justification
A. Le rattachement régulier aux méthodes d’interprétation « neutres »
B. Le rattachement régulier aux méthodes extensives
Chapitre 2 L’utilisation finaliste des sources internationales
Section 1. La mise en adéquation des sources internationales avec les objectifs poursuivis
§ 1. Le choix de la valorisation des sources internationales
A. La promotion d’une lecture pro homine§ 2. Le choix de la neutralisation des sources internationales
B. La préservation de la cohérence inter-systémique
A. La préservation de la souveraineté des États partiesSection 2. L’agencement judicieux des moyens avec les objectifs poursuivis
B. La revendication de la spécificité et de l’autonomie du système conventionnel
§ 1. La combinaison opportune des sources avec les méthodes d’interprétation
A. La priorisation des méthodes d’interprétation§ 2. L’instrumentalisation des sources internationales
B. L’instrumentalisation de la méthode consensuelle
A. La sélection des sources internationales
B. L’instrumentalisation de l’analogie
C. La dénaturation des sources internationales
DEUXIÈME PARTIE
LA FONCTION RÉGULATRICE
LA FONCTION RÉGULATRICE
Titre 1. La modulation du contrôle du respect des obligations conventionnelles
Chapitre 1. La modulation de la teneur du contrôle
Section 1. L’exercice ambivalent du contrôle textuellement intégré
§ 1. Un contrôle limité dans le cadre de l’article 15 et de l’article 1er du Protocole n° 1
A. Un contrôle obsolète dans le cadre de l’article 1 du Protocole n° 1§ 2. Un contrôle manifeste dans le cadre de l’article 7 de la Convention
B. Un contrôle externalisé dans le cadre de l’article 15
A. Le contrôle rigoureux de l’existence d’une base légale internationale
B. L’extension du contrôle à l’appréciation et la qualification des faits retenues par les juges internes
Section 2. Un contrôle étendu par la voie prétorienne
§ 1. L’intégration des sources internationales extérieures au contrôle de la Cour
A. Un contrôle régulièrement sollicité par les requérants§ 2. Le contrôle de l’interprétation et de l’application des sources internationales par les juges internes
B. Un contrôle indirectement exercé par la Cour
A. Un contrôle sollicité par les requérants
B. Un contrôle rigoureusement exercé par la Cour
Chapitre 2 La modulation de l’intensité du contrôle
Section 1. Un contrôle modulé par l’existence d’incompatibilités entre obligations internationales
§ 1. L’affirmation de la compétence juridictionnelle
§ 2. Un contrôle adapté en fonction de la marge de manœuvre reconnue aux États parties
§ 2. Un contrôle adapté en fonction de la marge de manœuvre reconnue aux États parties
A. L’exercice d’un contrôle restreint en cas d’absence de marge de manœuvreSection 2. Un contrôle modulé par la doctrine de la marge nationale d’appréciation
B. L’exercice d’un contrôle normal en cas de marge de manœuvre
§ 1. La marge nationale d’appréciation comme instrument naturel de modulation
A. Le rôle initialement joué par la marge nationale d’appréciation en amont du test de proportionnalité§ 2. La marge nationale d’appréciation détournée de sa fonction initiale
B. L’intégration des sources internationales dans la détermination de la marge nationale d’appréciation
A. L’instrumentalisation du consensus
B. La mutation de la fonction des sources internationales
Titre 2. La préservation de l’autorité de la cour
Chapitre 1. La fonction persuasive des sources internationales
Section 1. La persuasion par un effort accru de contextualisation
§ 1. Un contexte normatif international désormais affiché dans la rédaction des arrêts
§ 1. La justification des solutions adoptées
A. L’intégration d’une subdivision consacrée à l’exposé des sources internationales pertinentes§ 2. Les vertus persuasives de l’effort de contextualisation
B. Une subdivision généralement marquée du sceau de l’exhaustivité
A. Révéler la connaissance du juge du contexte dans lequel s’inscrit le contentieuxSection 2. La persuasion par la force de l’argumentation
B. Renforcer la position du juge
C. Un essai de persuasion à relativiser
§ 1. La justification des solutions adoptées
A. La justification de l’établissement des faits§ 2. La vocation confortative des sources internationales
B. La justification du raisonnement
A. L’utilisation fréquente des sources internationales comme arguments secondaires
B. Les effets pervers d’un tel procédé sur l’intelligibilité des décisions
Chapitre 2. L’organisation cohérente des rapports de systèmes
Section 1. La priorité donnée à l’évitement des conflits inter-systémiques
§ 1. La valorisation d’une approche harmonieuse des rapports inter-systémiques
A. La valorisation de la présomption de cohérence§ 2. Une hiérarchisation axiologique envisageable
B. La valorisation de la présomption de protection équivalente
A. Une hiérarchisation inévitableSection 2. Le développement d’un partenariat favorable au renforcement de la légitimité de la Cour
B. Une hiérarchisation aménageable
§ 1. Un partenariat favorable à la cohésion des systèmes de protection
A. Un partenariat valorisé à l’échelle régionale§ 2. Un partenariat nécessaire à la promotion du modèle européen
B. Un partenariat étendu hors des frontières de l’Europe
CONCLUSION GÉNÉRALE
I. L’utilisation des sources internationales comme instrument de mesure efficace de l’autonomie du jugeBibliographie thématique sélective
II. Les sources internationales comme instrument mis au service de la politique jurisprudentielle de la Cour
III. Les fonctions des sources internationales dans la jurisprudence de la Cour européenne : la réconciliation entre liberté et déterminismes
Index jurisprudentiel
Index thématique
Marion LARCHÉ, Les fonctions des sources internationales dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, Paris, Pedone, 2025 (650 pp.)
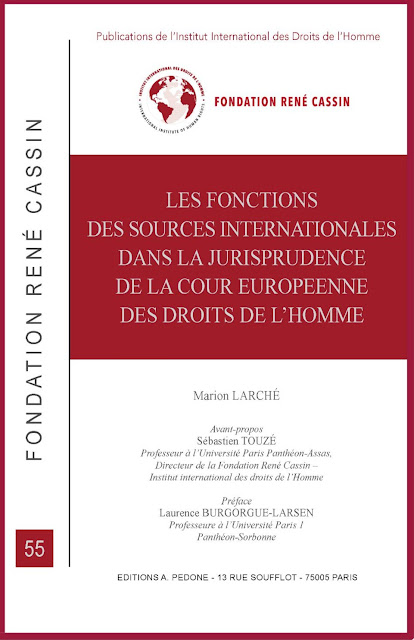
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire